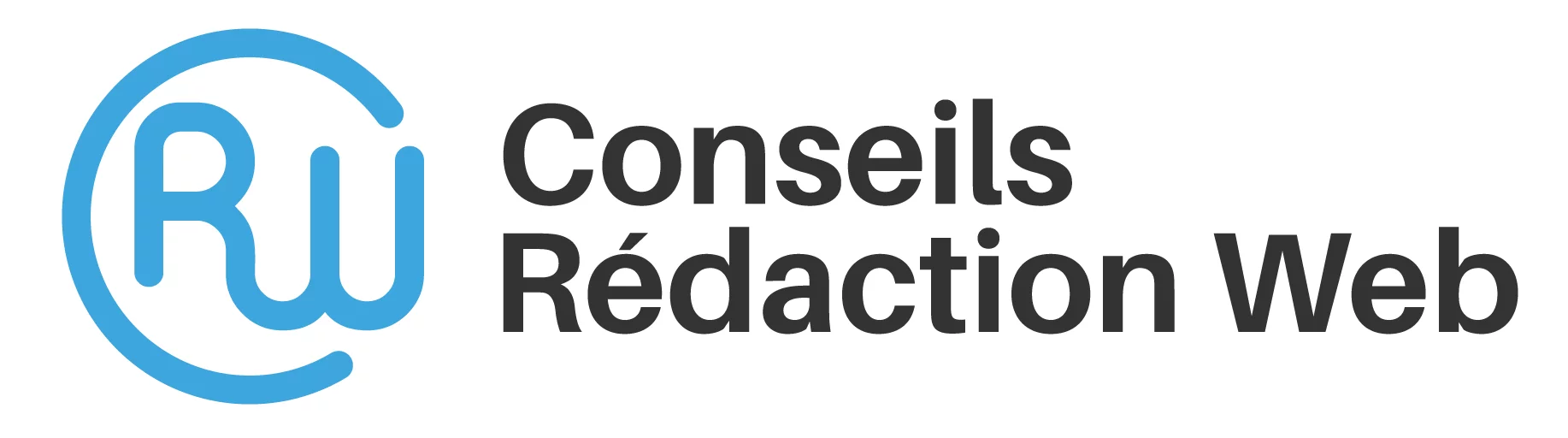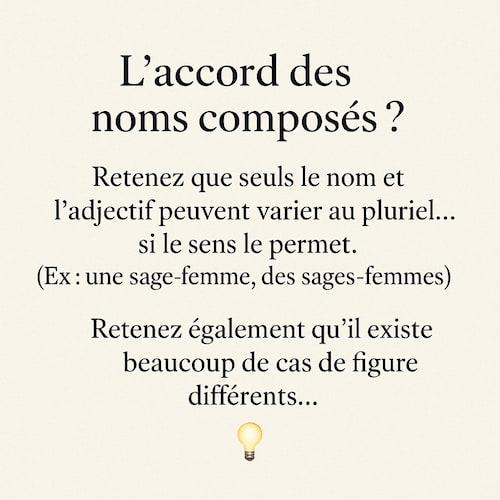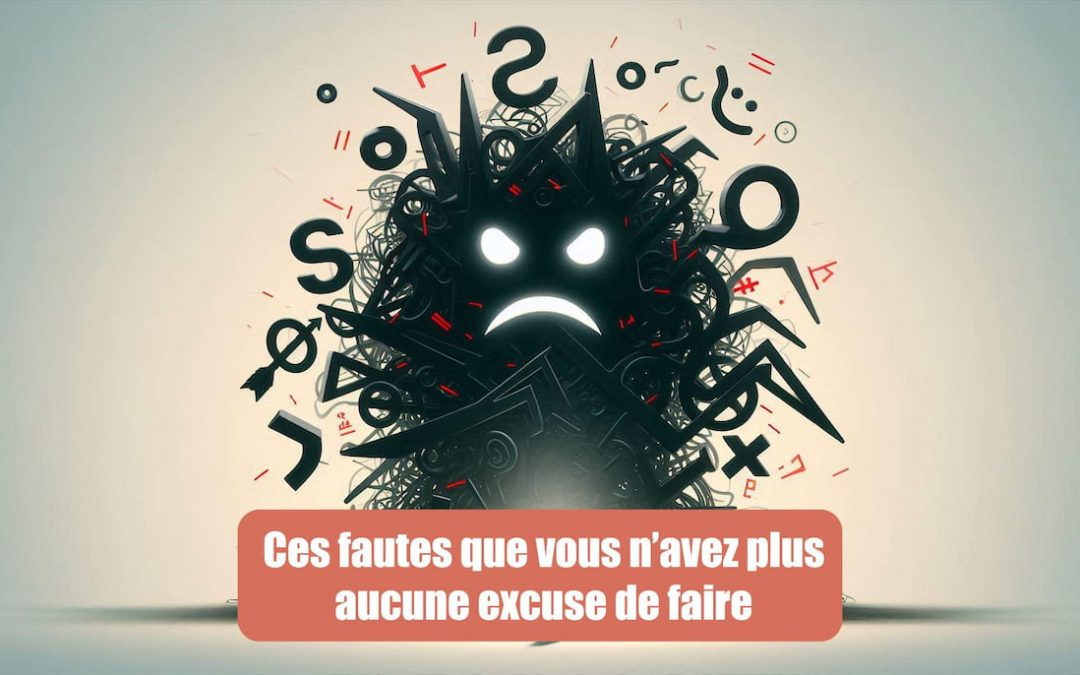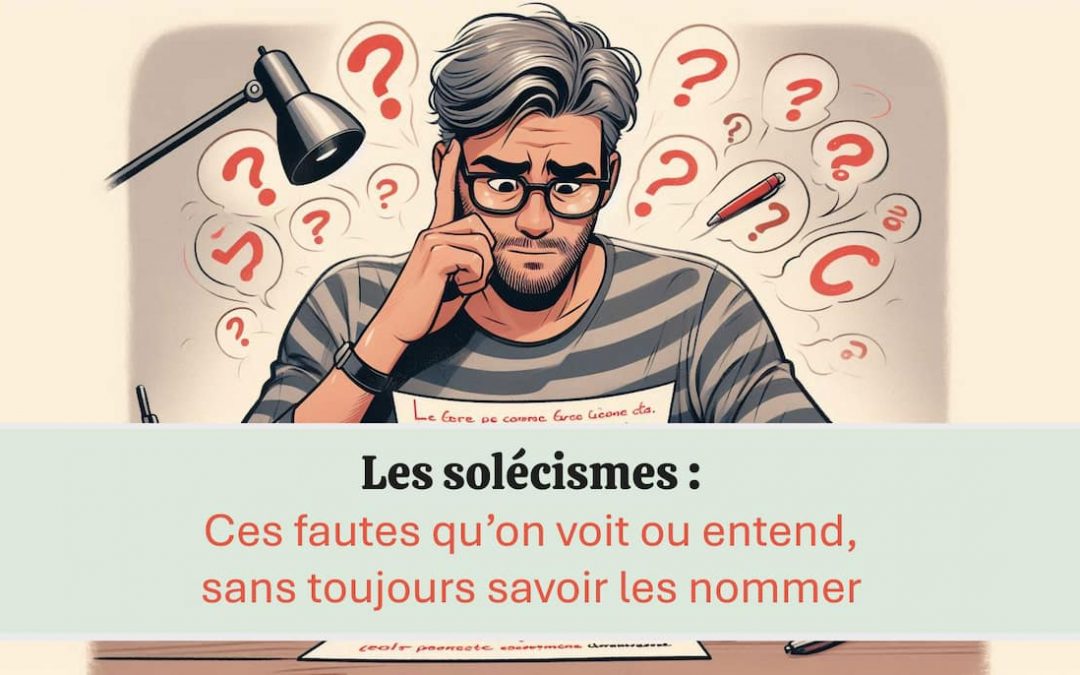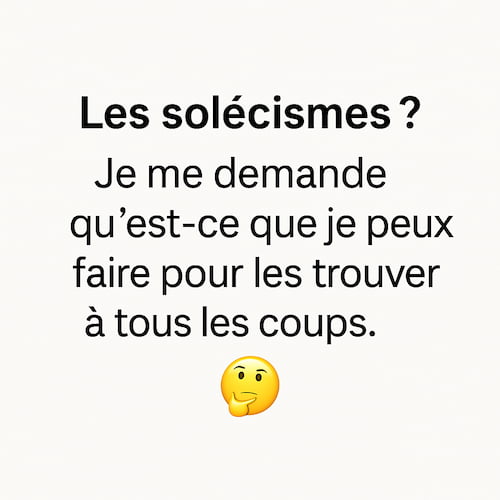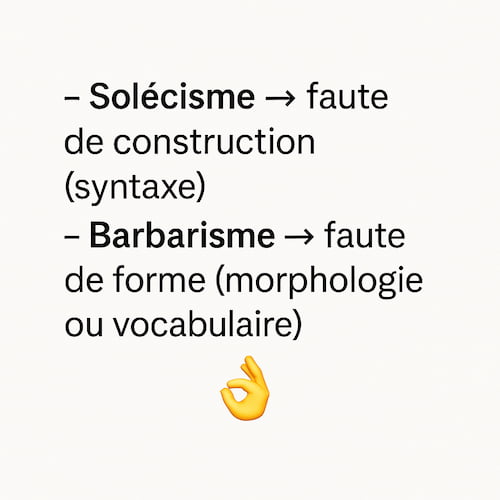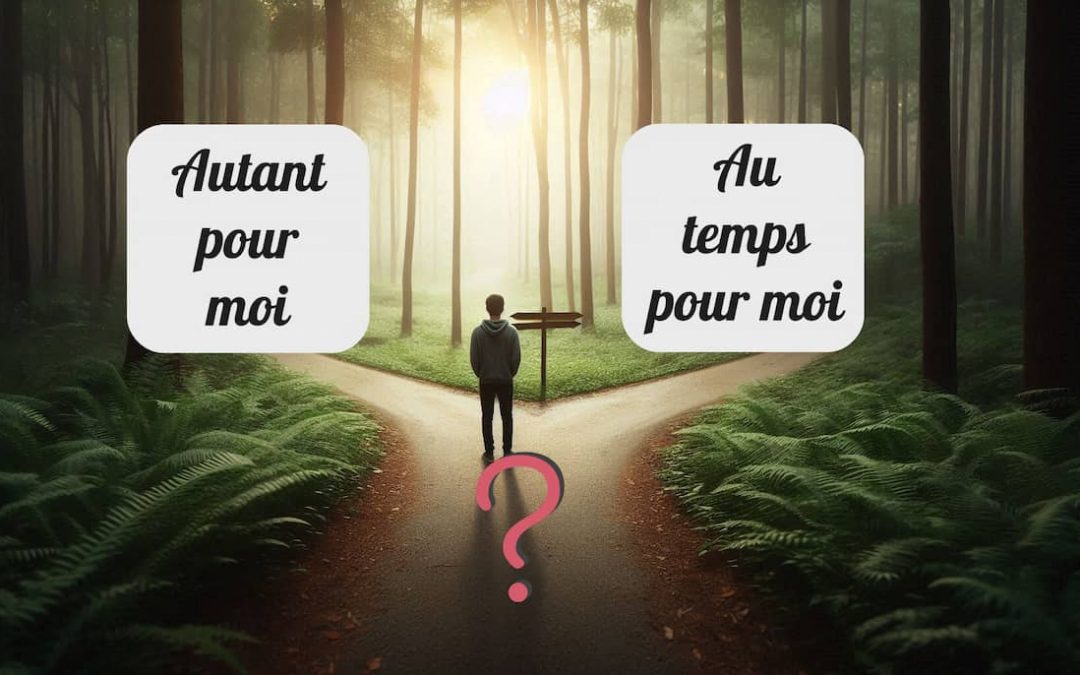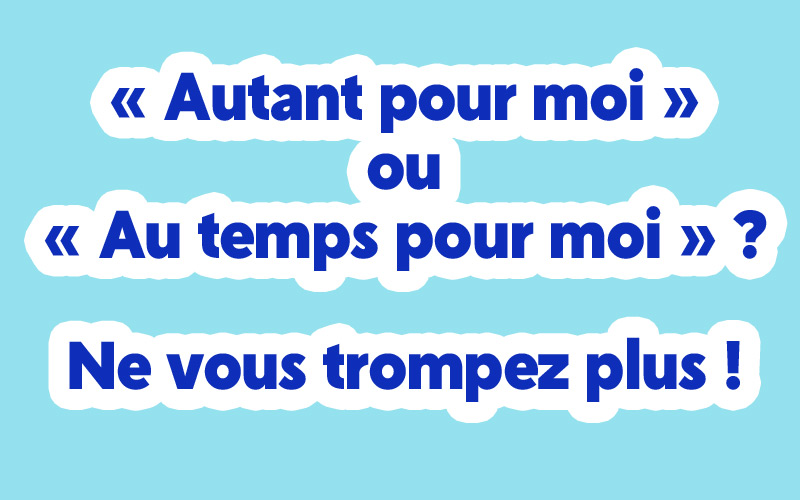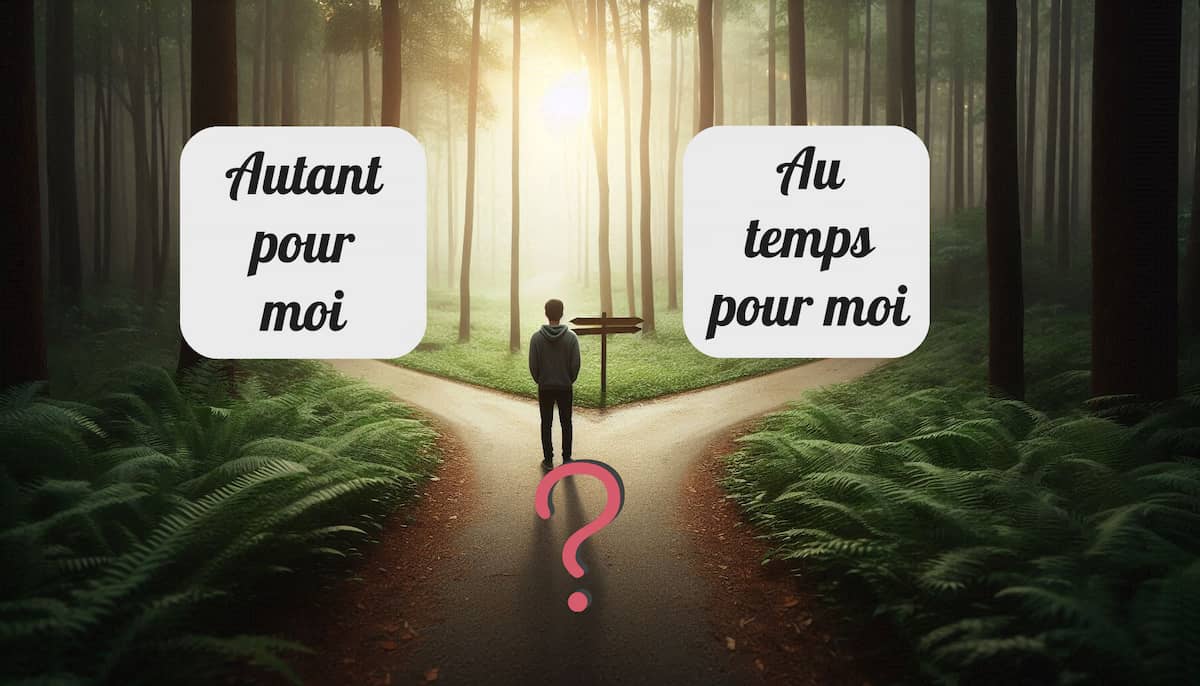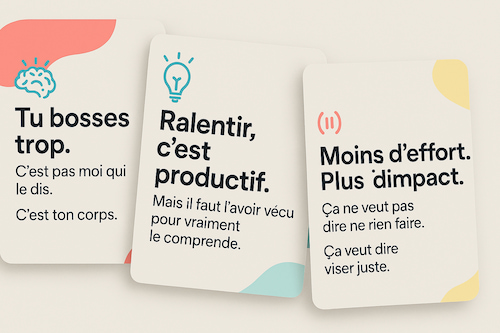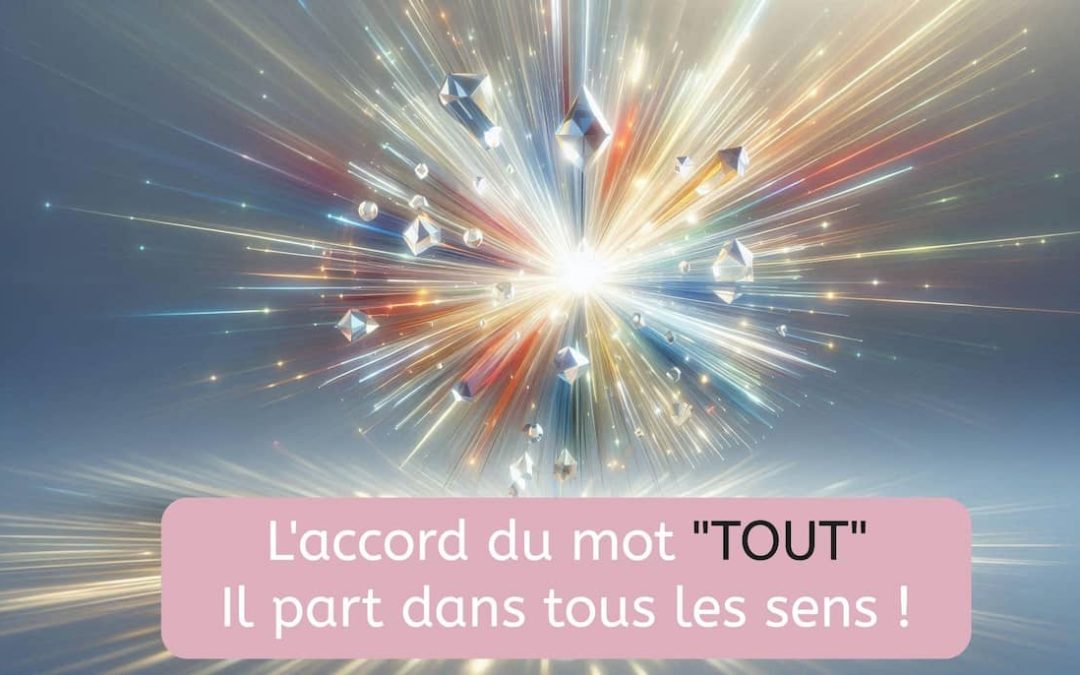
Tout, tous, toute : maîtrisez l’accord une bonne fois pour toutes !
La bonne utilisation de « tout », « tous » et « toute » est une source fréquente d’erreurs en français. Pourtant, en maîtrisant quelques règles simples, vous pourrez éviter de les confondre et enfin écrire avec justesse… une bonne fois pour toutes !

Les différentes natures grammaticales du mot « tout »
Dans le paysage vallonné de la langue française, certains mots se transforment et s’accordent au gré des situations, semant parfois le chaos dans nos esprits. « Tout », « tous » et « toute » figurent parmi ces petits éléments qui peuvent nous donner du fil à retordre et… de grands moments de solitude. Car le mot « tout » n’est pas une petite nature, et il donne du fil à retordre, par toutes les variations grammaticales qu’il peut prendre pour définir sa nature, justement.
💡Règle simple à retenir : « tout » peut être adjectif, adverbe ou nom.
Eh oui, tout cela à la fois !
A) Adjectif
« Tout » se rapporte à un nom ou à un pronom auquel il s’accorde. Plus précisément, il peut être :
➤ Adjectif qualificatif (au singulier), il signifie :
- « Tout entier » (placé devant un nom accompagné de l’article)
Exemple : Toute la famille est réunie. - « Seul »
Exemple : Pour toute excuse, il allégua son ignorance.
➤ Adjectif indéfini, il signifie :
- « Chaque, n’importe quel »
Exemple : À tout instant, je suis obligée de m’arrêter. - « Tous », sans exception
Exemple : Tous les voleurs fuient à toutes jambes.
Attention à l’usage
On écrit bien :
- De tout côté ou de tous côtés
- En tout sens ou en tous sens
B) Pronom indéfini
Quand « tout » remplace un nom, est sujet ou complément et quand il signifie :
- « Tout le monde, toutes les choses »
Exemple : Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. (La Fontaine) - « N’importe qui, n’importe quoi »
Exemple : Tout arrive à qui sait attendre.
C) Adverbe
« Tout » est adverbe lorsqu’il signifie :
→ « Tout à fait, entièrement, si, très », modifiant ainsi un adjectif, un adverbe, un verbe ou un nom.
Exemple : Des livres tout neufs.
Remarque :
Comme adverbe, « tout » est généralement invariable. Pour le reconnaître, c’est simple : on peut retirer « tout » de la phrase sans en altérer le sens.
Exemple :
Elle était devenue une tout autre fille
OU
C’est une tout autre histoire.
Mais comme souvent en français, quelques exceptions viennent compliquer les choses :
- Par euphonie, « tout » s’accorde devant les adjectifs féminins commençant par une consonne ou un h aspiré.
Exemple : La fleur toute blanche a ses feuilles toutes hérissées. - On admet également l’accord devant les adjectifs féminins commençant par une voyelle ou un h muet.
Exemple : La planète tout entière / La planète toute entière.
Cependant, « tout » reste adverbe (donc invariable) dans des expressions figées comme :
→ Tout en fleurs, être tout yeux, tout oreilles…
D) Nom
Lorsqu’il est précédé d’un article, « tout » devient un nom au sens de :
→ La totalité, l’ensemble.
Exemple : Donnez-moi le tout.
E) Adjectif ou adverbe devant l’adjectif « autre »
Ce cas pose souvent problème. Parfois on écrit toute autre solution, parfois tout autre reste invariable. Pourquoi ?
Tout dépend de la fonction grammaticale du groupe “tout autre” dans la phrase.
Cas n°1 : “tout autre” est adjectif épithète → on accorde
Quand le groupe tout autre qualifie directement un nom (il est épithète), “tout” s’accorde en genre et en nombre.
C’est le cas le plus fréquent à l’écrit.
Exemples :
• Une toute autre solution s’impose.
• Toutes les autres réponses étaient fausses.
Ici, tout autre est collé au nom qu’il qualifie (solution, réponses). On parle d’adjectif épithète.
Cas n°2 : “tout autre” est attribut → on n’accorde pas
Quand le groupe est relié au sujet par un verbe d’état (être, devenir, rester…), “tout” prend le sens de « entièrement ». Comme on l’a vu plus haut, il devient alors adverbe et reste invariable.
Exemples :
• Ces propositions sont tout autres.
• Il est tout autre depuis son accident.
Ici, tout autre ne qualifie pas directement un nom mais complète le verbe. On parle d’attribut du sujet.
Et comme tout est devenu un adverbe d’intensité, il ne s’accorde pas.
Astuce pour ne pas se tromper
Posez-vous la question :
👉 Est-ce que je pourrais remplacer “tout” par “entièrement” ?
- Si oui → c’est un adverbe, donc invariable.
- Si non → c’est un adjectif, donc accord obligatoire.
Accord de « Tout » : tout est question d’entraînement !
Avez-vous bien lu cet article ? Passez le quiz !
Écrivez correctement « tout » dans les expressions suivantes. Vous avez 3 vies.